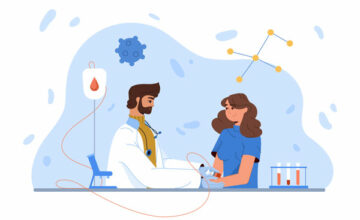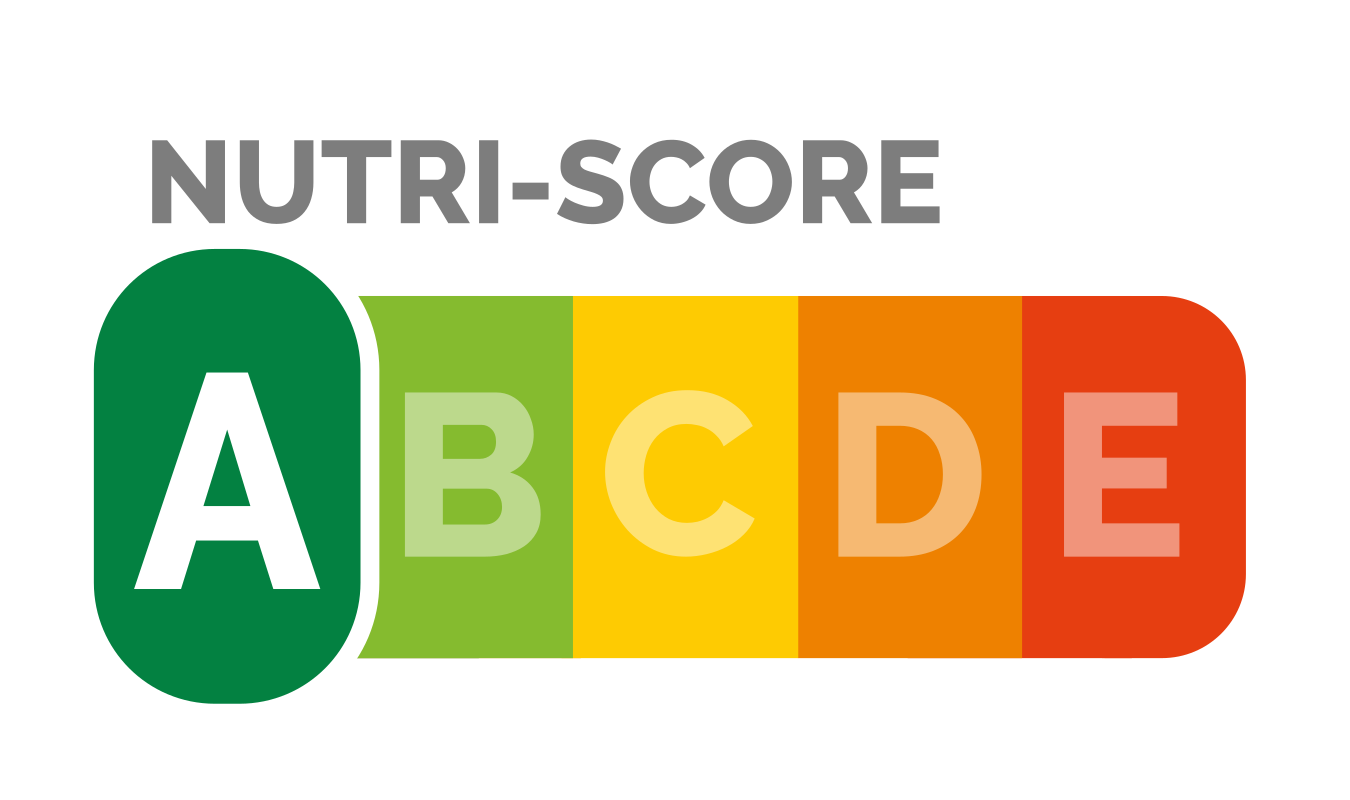Chaque année, la Semaine européenne de prévention et d’information sur l’endométriose nous rappelle qu’il n’est pas normal qu’une femme souffre pendant ses règles. Si de légères crampes menstruelles sont habituelles, la douleur devient suspecte quand elle ne disparait pas avec un simple antalgique. Elle doit inciter au dépistage d’une éventuelle endométriose.
Des douleurs violentes dans le bas du ventre, mais aussi dans les cuisses, voire les épaules, pendant les règles, sont un signe qui devrait systématiquement alerter les femmes et les médecins. N’écoutez ni votre mère, ni votre grand-mère, ni les copines, si elles vous disent qu’il est normal d’avoir mal à la fin du cycle menstruel. Ni même le gynécologue qui vous prendrait pour une petite nature et vous expliquerait que c’est dans l’ordre des choses. Cette croyance, bien ancrée culturellement, qui voudrait faire du corps des femmes le lieu d’une souffrance inexorable, a la vie dure. Heureusement, elle s’effrite peu à peu, grâce à l’action d’associations et aux témoignages de patientes expertes qui ont décidé, à juste titre, que les « coups de poignard » subits par leur ventre ne reflétaient en rien un état naturel immuable. Une douleur qui handicape, tout comme des rapports sexuels déplaisants, voire éprouvants, ou des troubles de la fertilité, doivent inciter à dépister une éventuelle endométriose. Car cette maladie, bien que bénigne au sens médical du terme (elle n’impacte pas le pronostic vital), continue à pourrir la vie personnelle, sociale et professionnelle de millions de femmes en âge de procréer. Heureusement, les mentalités changent : cent cinquante ans après sa découverte, l’endométriose est enfin entrée dans les programmes des études de médecine en septembre 2020, et le gouvernement a doté le pays d’une stratégie nationale contre l’endométriose, présentée le 14 février 2022 par Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, à l’hôpital Saint-Joseph (Paris).
Trois signes qui ne trompent pas
« Les médecins ont coutume de dire que des règles douloureuses pourraient être un symptôme de l’endométriose si la douleur :
– est cyclique et revient avec les règles,
– résiste à un simple antalgique type paracétamol,
– empêche de mener à bien ses activités quotidiennes (empêche de se lever, de travailler, d’aller en cours) ».
Source : EndoFrance.
Comprendre une maladie complexe
Pour rappel, l’intérieur de l’utérus est tapissé d’une muqueuse que l’on appelle l’endomètre. Destiné à accueillir l’embryon après la fécondation, il n’a pas d’utilité si aucun spermatozoïde n’a pu rencontrer d’ovule, et il est donc évacué par l’utérus au moment des règles, principalement via le vagin. Cependant, une infime partie se diffuse dans l’abdomen en passant par les trompes. Ce « reflux menstruel », ou « saignement rétrograde« , mis en évidence par le gynécologue américain John A. Sampson en 1927, est, dans la majorité des cas, sans conséquence, le sang et les cellules endométriales étant supprimés par le système immunitaire. Mais, selon l’hypothèse la plus communément admise, ce phénomène serait délétère pour au moins 10 % des femmes et entraînerait, chez elles, une endométriose. Des fragments de tissu endométrial se fixeraient et se développeraient anormalement dans les ovaires, les ligaments qui soutiennent l’utérus et les trompes de Fallope, mais aussi parfois dans le vagin, l’intestin, l’appareil urinaire et, bien que très rarement, dans l’abdomen, le thorax ou les poumons. En 2019, des médecins français ont ainsi diagnostiqué une endométriose péricardique (le péricarde est la poche qui entoure le cœur) chez une femme venue consulter pour des douleurs dans la poitrine survenant pendant ses règles. Deux cas d’endométriose atteignant le cerveau ont été rapportés à ce jour.
D’autres hypothèses coexistent sans s’exclurent. Le passage de cellules de l’endomètre utérin vers les autres organes pourrait se faire par le sang ou la lymphe, un peu à la manière des cellules cancéreuses (mais sans cellules malignes et sans risque de décès). Des cellules du péritoine (la membrane qui soutient les organes de l’abdomen) pourraient spontanément se transformer en cellules de l’endomètre. Des lésions d’endométriose pourraient venir des restes embryonnaires. Enfin, des transformations épigénétiques survenues dans les cellules endométriales normales pourraient être à l’origine de l’apparition des lésions d’endométriose. Quant à savoir pourquoi ces tissus se propagent dans le corps de certaines femmes, la question reste en suspens. Peut-être en raison d’un système immunitaire « défaillant », incapable de supprimer ces tissus en fin de cycle, d’anomalies vasculaires ou moléculaires, ou encore de facteurs génétiques ou environnementaux, voire psychologiques, qui font aujourd’hui l’objet de nombreuses recherches.
A noter : une endométriose n’est pas systématiquement pathologique et peut rester totalement asymptomatique. Elle n’est considérée comme une maladie que lorsqu’elle provoque des douleurs et/ou une infertilité, c’est-à-dire quand elle provoque des lésions qui agissent comme de véritables tumeurs bénignes et désorganisent le fonctionnement normal de certains organes ou fonctions physiologiques. Beaucoup de femmes vivent avec une endométriose sans le savoir, et n’auront jamais mal.
Rechercher les facteurs de risques
Les chercheurs commencent à dessiner les portraits de certains profils à risque à partir de recherches épidémiologiques encore peu nombreuses. Les femmes qui ont eu leurs premières règles précocement, celles qui ont des cycles courts, inférieurs à 27 jours, celles qui on un indice de masse corporel faible, sont statistiquement plus touchées par l’endométriose (en anglais). Des études récentes, qui portent sur l’exposition à certains perturbateurs endocriniens, révèlent des associations significatives entre les niveaux de ces polluants dans le corps et la présence d’endométriose profonde, rendant plausible un éventuel lien de cause à effet. Les facteurs génétiques commencent à être mieux connus. On sait que le risque de développer une endométriose pour les apparentées au premier degré (une mère, une sœur) est cinq fois plus élevé que dans la population générale. En 2021, une équipe de recherche a pu mettre en évidence un gène de susceptibilité à l’endométriose, en analysant l’ADN de familles dans lesquelles au moins trois femmes étaient atteintes de cette maladie. Enfin, les abus dans l’enfance (sévices sexuels et physiques) seraient aussi associés à un risque accru d’endométriose, comme le suggère une étude de l’Hôpital universitaire de Zurich publiée dans la revue Human Reproduction (en anglais).
Une chose est certaine : les conditions d’apparition de cette affection multifactorielle sont particulièrement complexes à comprendre.
Diagnostiquer
« Le retard de diagnostic est encore de 7 à 9 ans, ce qui est considérable », nous explique le docteur Erick Petit dans un épisode en préparation du podcast Les voix de la prévention. En cause, la méconnaissance de nombreux médecins, pour lesquels la douleur féminine n’est pas un sujet médical. Mais aussi un véritable négationnisme parmi des gynécologues vieillissants, vexés d’être passés à côté de la maladie.
Toute consultation d’une femme qui déclare avoir mal pendant ses règles devrait pourtant alerter et commencer par un questionnaire précis qui permet de savoir presque à coup sûr si la personne est atteinte d’endométriose. Des relations sexuelles douloureuses, une gêne lors de la miction, un inconfort digestif, une défécation difficile, sont autant de signes qui peuvent indiquer la présence de la maladie.
Quand elle est devenue chronique et ne concerne plus seulement la période des règles, c’est souvent que des fibres nerveuses sont atteintes : les douleurs neuropathiques, différentes des douleurs inflammatoires, explique Marie-Rose Galès dans son livre Endométriose : ce que les autres pays ont à nous apprendre, « provoquent des espèces de décharges, des pincements, des brûlures… ». C’est ainsi qu’une forme rare de l’endométriose, atteignant le diaphragme, peut être diagnostiquée à partir d’une douleur chronique à l’épaule droite !
Enfin, dans 25 à 50 % des cas, la maladie entraînerait une infertilité (et non pas une stérilité) pour des raisons qui sont encore très discutées mais concernent la perturbation de l’ovulation, du transport des gamètes ou de l’implantation de l’embryon… Qu’elle soit douloureuse ou non (asymptomatique), l’endométriose pourra être diagnostiquée lors d’un bilan d’infertilité.
Après ce premier entretien permettant de suspecter une endométriose, le médecin prescrit des examens médicaux qui permettront de confirmer l’hypothèse. L’IRM est l’examen le plus courant mais l’échographie endovaginale est l’examen le plus efficace. Cette technique, qui consiste à introduire une sonde dans le vagin pour détecter des lésions, même infimes (de l’ordre de 1 millimètre), est malheureusement trop rarement pratiquée car elle exige une formation longue et une expertise que peu de radiologues possèdent.
Ecouter : de la douleur physique à la souffrance psychologique
Parmi les femmes atteintes d’endométriose, les plus « chanceuses » n’auront mal qu’au moment de leurs règles, et les plus malheureuses souffriront en permanence. On ne parle pas ici des légères crampes qui peuvent être ressenties pendant un ou deux jours au début des menstrues, mais bien de douleurs qui accaparent la pensée, focalisent l’attention, et plongent celles qui souffrent dans un profond mal-être. La douleur chronique, ponctuée de crises violentes que les patientes décrivent « comme des coups de poignard, ou d’aiguilles qui transpercent », ne concerne pas seulement la zone pelvienne, mais aussi l’appareil digestif et le système musculo-squelettique.
On parle de douleur chronique quand on n’arrive pas à la calmer et qu’elle persiste au-delà de trois mois. Ce n’est alors plus un symptôme mais une maladie. Plus la douleur est vive et longue, plus elle a un impact psychologique important. Après des mois, et souvent des années, à avoir mal, beaucoup de patientes, fréquemment en situation d’errance diagnostique, qui se sont parfois fait traiter de folles par des médecins et des gynécologues, estimant qu’ils ont affaire à des chochottes, sont fatiguées, anxieuses et déprimées. Les femmes souffrant d’endométriose sont souvent psychiquement tourmentées ou bouleversées, explique la psychologue Sophie Younes. Elles ont un rapport au corps altéré : « c’est le corps souffrant, c’est le corps ennemi, c’est le corps qu’on n’écoute plus, sinon au moment des douleurs et, là, on l’écoute sur un mode hostile. Et cela prend beaucoup de place, parfois toute la place ». C’est d’autant plus vrai que la douleur perturbe la vie amoureuse, teinte les relations sexuelles d’appréhension, voire les empêche. Dans un monde où le sang des règles est symboliquement l’objet de tabous et où la science a longtemps considéré les douleurs menstruelles comme « une expression pathologique liée à la psyché particulière de la femme », c’est la triple peine : les femmes ont mal, elles sont épuisées et elles culpabilisent. Parfois, quatrième peine, elles désespèrent d’avoir un enfant.
Prendre en charge
Dès lors que la maladie est diagnostiquée, le traitement de première intention est une contraception hormonale, mais elle est uniquement envisageable si la patiente n’a pas exprimé de désir de grossesse. On supprime tout simplement les symptômes en supprimant les règles, à l’aide de pilules prises en continu, complétées d’antalgiques, le temps que la douleur régresse. La Haute Autorité de Santé rappelle que certaines prises en charge non médicamenteuses peuvent améliorer la qualité de vie des patientes. Elle conseille, en particulier, l’acupuncture, l’ostéopathie et le yoga.
Selon l’intensité de la douleur et la localisation des lésions et des kystes, ainsi que des attentes de la patiente en terme de grossesse, une chirurgie peut être proposée. Invasive et parfois invalidante, elle ne traite pas la cause, n’empêche pas nécessairement la maladie de revenir et ne devrait plus être le traitement de référence de l’endométriose selon l’INSERM. Elle concerne cependant 30 à 40 % des femmes atteintes de la maladie et peut s’avérer nécessaire quand la douleur ne peut plus être maîtrisée par les médicaments, quand une atteinte majeure d’un organe est constaté, ou encore quand des kystes d’endométriose de taille importante (plus de 4 à 5 cm), découverts dans l’utérus, pourraient compromettre un projet de grossesse, que celle-ci soit spontanée ou accompagnée dans une démarche de procréation médicalement assistée (PMA).
En 2021, l’identification du gène NPSR1, associé aux formes graves d’endométriose, a fait couler beaucoup d’encre et a suscité un fort espoir de traitement. Aux titres parfois un peu racoleurs de la presse, il faut pourtant opposer un bémol : il existe au moins 14 variants génétiques impliqués dans la maladie qui, rappelons-le, est plurifactorielle. Il serait donc illusoire de penser la guérir en ne traitant qu’un gène. Toutefois, cette découverte pourrait permettre, dans quelques années, de proposer une alternative aux traitements hormonaux, ce que ne bouderont pas les patientes qui souhaitent porter un enfant. Elle pourrait aussi rendre possible un dépistage précoce. Mais, pour le moment, aucune avancée scientifique ne permet d’apporter de solution pour guérir la maladie.
Agir : une stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, enfin !
« Les douleurs menstruelles ne sont pas une fatalité, et l’endométriose n’est pas dans la tête : c’est une maladie à part entière, qui nécessite une réponse adaptée ». Il s’agit de la première phrase du dossier de presse de la Stratégie nationale de lutte contre l’endométriose (PDF), présentée le 14 février 2022 par le Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. On ose enfin parler haut et fort de cette maladie ! Les patientes, accompagnées de quelques médecins et chercheurs, après avoir réclamé activement qu’on les écoute, seront à présent vigilantes que les promesses soient tenues : financement de la recherche scientifique, diagnostic rapide, accès aux soins de qualité sur l’ensemble du territoire, information de la société sur ce sujet encore trop tabou et encore souvent négligé par le corps médical, notamment par certains médecins généralistes quelque peu archaïques. Il s’agit, sans aucun doute, d’un tournant dans la reconnaissance d’une maladie qui empoisonne près de 4 millions de femmes en France et qui a affecté le bien-être physique, mental et social de générations de femmes silencieuses avant elles.
Consultez le podcast d’Erick Petit. a la poursuite de l’endométriose
Texte : © J.-C. Moine/ Ethnomedia
Photo : © Jelena Stanojkovic / Adobe Stock